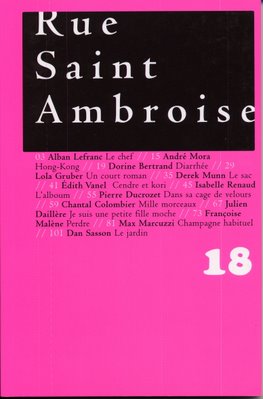12.11.06
Alban Lefranc
Le chef
En 1977 à Munich, un homme au visage bouffi, les yeux pleins de rage et de force, chasse son ami de leur appartement. Il le saisit par les épaules, secoue l’imposante masse de chair qui le faisait jouir tout à l’heure, ouvre la porte en criant. Il passe des coups de fil en France et en Allemagne, il est question d’avion détourné. Un peu plus tard il renverse des meubles.
Quand on lui demande ce qu’il cherche dans ses films il répond crises, déclencher des crises, voir ce qui sort de la crise, la crise est son élément, qu’il vaut mieux un couple en crise que dans le mensonge, qu’on n’est jamais assez plongé dans la catastrophe – le journaliste ne s’aventure pas à lui demander s’il y a des couples heureux. On ne comprend pas tout : la fatigue dans son corps, mais plus encore le refus de la fatigue disperse ses mots avant qu’ils ne parviennent, presque trente ans après, sur un écran de télévision au-dessus d’une moquette grise à Paris. De son souffle éreinté montent péniblement des phrases qu’il jette de toutes ses forces à travers l’espace. C’est un clochard au bizarre accent bavarois, une allure de plouc beauf au milieu des gros richards de Munich. Un clochard, pas un Falstaff. On lui donne une cinquantaine d’années, l’âge indéfinissable du vieux en bas de la rue, qu’on se surprend à vouloir tuer pour ne plus le voir.
En 1977 à Munich, un homme au visage bouffi, les yeux pleins de rage et de force, chasse son ami de leur appartement. Il le saisit par les épaules, secoue l’imposante masse de chair qui le faisait jouir tout à l’heure, ouvre la porte en criant. Il passe des coups de fil en France et en Allemagne, il est question d’avion détourné. Un peu plus tard il renverse des meubles.
Quand on lui demande ce qu’il cherche dans ses films il répond crises, déclencher des crises, voir ce qui sort de la crise, la crise est son élément, qu’il vaut mieux un couple en crise que dans le mensonge, qu’on n’est jamais assez plongé dans la catastrophe – le journaliste ne s’aventure pas à lui demander s’il y a des couples heureux. On ne comprend pas tout : la fatigue dans son corps, mais plus encore le refus de la fatigue disperse ses mots avant qu’ils ne parviennent, presque trente ans après, sur un écran de télévision au-dessus d’une moquette grise à Paris. De son souffle éreinté montent péniblement des phrases qu’il jette de toutes ses forces à travers l’espace. C’est un clochard au bizarre accent bavarois, une allure de plouc beauf au milieu des gros richards de Munich. Un clochard, pas un Falstaff. On lui donne une cinquantaine d’années, l’âge indéfinissable du vieux en bas de la rue, qu’on se surprend à vouloir tuer pour ne plus le voir.
André Mora
Hong Kong
Je lui massais la nuque et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il suffisait de laisser glisser mes mains vers son cou et de serrer un peu pour la voir morte. Elle avait relevé ses cheveux blonds pour que je puisse poser mes paumes à la base de sa nuque. Le col de sa chemise me gênait et je l’écartai un peu. Elle avait la peau très pâle, diaphane. Sous mes doigts, ses muscles roulaient doucement. Eux aussi, j’avais envie de les tirer jusqu’à ce qu’ils claquent. Je n’avais aucun désir de la tuer, pourtant. Peut-être que je voulais seulement la voir morte, comme un visage d’elle-même qu’elle aurait tenu secret pour tout autre que moi.
— Tu masses toujours aussi bien. Si un jour tu es au chômage, tu pourras toujours te reconvertir...
— C’est parce que tu m’as manqué. Mes mains se souviennent. Elles sont contentes de te voir.
— Les mains ne voient pas...
— C’est ce que tu crois.
Mes mains reconnaissaient chaque pore de sa peau, chaque mèche échappée de ses cheveux relevés. Chaque journée de son absence. C’était peut-être pour ça aussi qu’elles avaient envie de se refermer sur elle comme des serres.
— Peut-être que tu as raison, remarque. Parce qu’il a fallu que ce soit justement aujourd’hui que j’aie mal au cou. Ça ne m’était plus arrivé depuis des années. Et personne d’autre n’aurait pu me soulager séance tenante aussi bien.Je hochai la tête dans son dos. Puis je me concentrai sur le mouvement de mes doigts. Cercles s’éloignant du centre, vagues de chair repoussant la douleur, laissant derrière elles une mer lisse de peau assouplie. J’avais toujours eu ce pouvoir de la calmer, cette vieille douleur souvenir justement reparue aujourd’hui.
Je lui massais la nuque et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il suffisait de laisser glisser mes mains vers son cou et de serrer un peu pour la voir morte. Elle avait relevé ses cheveux blonds pour que je puisse poser mes paumes à la base de sa nuque. Le col de sa chemise me gênait et je l’écartai un peu. Elle avait la peau très pâle, diaphane. Sous mes doigts, ses muscles roulaient doucement. Eux aussi, j’avais envie de les tirer jusqu’à ce qu’ils claquent. Je n’avais aucun désir de la tuer, pourtant. Peut-être que je voulais seulement la voir morte, comme un visage d’elle-même qu’elle aurait tenu secret pour tout autre que moi.
— Tu masses toujours aussi bien. Si un jour tu es au chômage, tu pourras toujours te reconvertir...
— C’est parce que tu m’as manqué. Mes mains se souviennent. Elles sont contentes de te voir.
— Les mains ne voient pas...
— C’est ce que tu crois.
Mes mains reconnaissaient chaque pore de sa peau, chaque mèche échappée de ses cheveux relevés. Chaque journée de son absence. C’était peut-être pour ça aussi qu’elles avaient envie de se refermer sur elle comme des serres.
— Peut-être que tu as raison, remarque. Parce qu’il a fallu que ce soit justement aujourd’hui que j’aie mal au cou. Ça ne m’était plus arrivé depuis des années. Et personne d’autre n’aurait pu me soulager séance tenante aussi bien.Je hochai la tête dans son dos. Puis je me concentrai sur le mouvement de mes doigts. Cercles s’éloignant du centre, vagues de chair repoussant la douleur, laissant derrière elles une mer lisse de peau assouplie. J’avais toujours eu ce pouvoir de la calmer, cette vieille douleur souvenir justement reparue aujourd’hui.
Dorine Bertrand
Diarrhée
Ça commence au milieu de la dictée. Thibaut lève le stylo et baisse les yeux sur son nombril. Il vient de gronder, une plainte sourde et familière qui ne demande qu’à se répéter. Ça y est. Son voisin interroge son propre ventre du regard, puis celui de Thibaut qui émet un nouveau son en réponse à sa question. Les deux élèves de devant se retournent. Ils ont entendu aussi. Le voisin s’écarte en reniflant.
– Ça va chier, il lance aux autres qui ricanent bêtement.
Thibaut grimace à la ronde, glisse sa main libre sur son ventre comme s’il voulait le faire taire puis lâche le stylo qu’il tient en suspens sur sa dictée. Les glouglous redoublent dans ses mains. Ça bouge. Des masses roulent de part et d’autre. Il serre les fesses, ferme les yeux. « Le Chieur de service », « Vachier », « Puduc », ces noms qu’ils lui donnent. Un éclair rouvre ses paupières. La moitié de la classe le regarde, l’autre lève le doigt pour alerter la prof de français qui se précipite à ses pieds.
– Tu veux que je t’accompagne ?
Une vague de beurk déferle sur la classe.
– Taisez-vous ! la prof lui aboie dessus.
Thibaut sursaute. Sa prof lui renvoie un sourire désolé. Elle prend sa doudoune, son cartable et sa main qu’elle serre fort dans l’escalier. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Cinq fois en cinq mois qu’il quitte le cours de français. La cour est déserte. Sa prof toute blanche, le front plissé.– Ça va aller, hein ? elle murmure d’un ton lugubre.
Ça commence au milieu de la dictée. Thibaut lève le stylo et baisse les yeux sur son nombril. Il vient de gronder, une plainte sourde et familière qui ne demande qu’à se répéter. Ça y est. Son voisin interroge son propre ventre du regard, puis celui de Thibaut qui émet un nouveau son en réponse à sa question. Les deux élèves de devant se retournent. Ils ont entendu aussi. Le voisin s’écarte en reniflant.
– Ça va chier, il lance aux autres qui ricanent bêtement.
Thibaut grimace à la ronde, glisse sa main libre sur son ventre comme s’il voulait le faire taire puis lâche le stylo qu’il tient en suspens sur sa dictée. Les glouglous redoublent dans ses mains. Ça bouge. Des masses roulent de part et d’autre. Il serre les fesses, ferme les yeux. « Le Chieur de service », « Vachier », « Puduc », ces noms qu’ils lui donnent. Un éclair rouvre ses paupières. La moitié de la classe le regarde, l’autre lève le doigt pour alerter la prof de français qui se précipite à ses pieds.
– Tu veux que je t’accompagne ?
Une vague de beurk déferle sur la classe.
– Taisez-vous ! la prof lui aboie dessus.
Thibaut sursaute. Sa prof lui renvoie un sourire désolé. Elle prend sa doudoune, son cartable et sa main qu’elle serre fort dans l’escalier. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Cinq fois en cinq mois qu’il quitte le cours de français. La cour est déserte. Sa prof toute blanche, le front plissé.– Ça va aller, hein ? elle murmure d’un ton lugubre.
Lola Gruber
Un court roman
Ils avaient en commun d’aimer les livres, le jeune homme ‑ on pouvait encore dire jeune, à son âge, pour un homme on pouvait, quoiqu’il commençât à sentir une lassitude, qui l’envahissait parfois par bouffées abruptes, abrutissantes, et qui invalidait cet adjectif ou en annonçait la prochaine disparition ‑, et la jeune femme, elle était un peu plus jeune que lui mais la différence de leurs sexes face au passage du temps les mettait, sur cette question, à égalité.
Des livres qu’ils aimaient, ils parlaient souvent et volontiers, cela occupait une part importante de leur conversation. Mais la jeune femme, vraiment, en avait lu beaucoup, ce que le jeune homme finissait par trouver irritant. Qu’il mentionne le titre d’un seul, et aussitôt elle s’en emparait, l’accablant de commentaires, allant jusqu’à mentionner des passages qu’il avait lui-même oubliés, et il s’en trouvait alors aussi admiratif que vexé ; de cette façon, les livres qu’il aimait se mêlaient, indifférents, à ceux, tous, qu’elle avait déjà lus, cette femme qui était, par-dessus le marché, un peu plus jeune que lui, jeune encore, et belle, ça ne durerait pas éternellement.Mais lors de l’une de leurs rencontres, il évoqua un court roman découvert récemment et qu’il avait aimé. Elle le connaissait, ce livre, bien sûr ? Non, jamais entendu parler. Enfin ! s’exclama-t-il, il existait tout de même un livre qu’elle n’ait pas lu ! Dans son triomphe perçaient ses exaspérations précédentes, un éclat hostile, comme un bref coup d’aiguille...
Ils avaient en commun d’aimer les livres, le jeune homme ‑ on pouvait encore dire jeune, à son âge, pour un homme on pouvait, quoiqu’il commençât à sentir une lassitude, qui l’envahissait parfois par bouffées abruptes, abrutissantes, et qui invalidait cet adjectif ou en annonçait la prochaine disparition ‑, et la jeune femme, elle était un peu plus jeune que lui mais la différence de leurs sexes face au passage du temps les mettait, sur cette question, à égalité.
Des livres qu’ils aimaient, ils parlaient souvent et volontiers, cela occupait une part importante de leur conversation. Mais la jeune femme, vraiment, en avait lu beaucoup, ce que le jeune homme finissait par trouver irritant. Qu’il mentionne le titre d’un seul, et aussitôt elle s’en emparait, l’accablant de commentaires, allant jusqu’à mentionner des passages qu’il avait lui-même oubliés, et il s’en trouvait alors aussi admiratif que vexé ; de cette façon, les livres qu’il aimait se mêlaient, indifférents, à ceux, tous, qu’elle avait déjà lus, cette femme qui était, par-dessus le marché, un peu plus jeune que lui, jeune encore, et belle, ça ne durerait pas éternellement.Mais lors de l’une de leurs rencontres, il évoqua un court roman découvert récemment et qu’il avait aimé. Elle le connaissait, ce livre, bien sûr ? Non, jamais entendu parler. Enfin ! s’exclama-t-il, il existait tout de même un livre qu’elle n’ait pas lu ! Dans son triomphe perçaient ses exaspérations précédentes, un éclat hostile, comme un bref coup d’aiguille...
Derek Munn
Le sac
Je vous laisse vous installer, ranger vos affaires. Je reviendrai tout à l’heure.
Elle sort. Il y a un décalage entre les bruits et les mouvements.
J’entends la serrure. Puis.
Silence.
Elle s’adressait à moi. Il m’a fallu un moment pour m’en rendre compte. La personne qu’elle a laissée seule dans cette pièce, c’est moi aussi. Je voulais lui dire que je n’avais pas fini, mais elle a été trop rapide.
À la fenêtre je pensais voir la rue. Je voulais la voir partir. Pas elle. Ma femme. J’ai peut-être oublié de lui dire quelque chose. Je ne sais pas. Elle aurait été sur le trottoir. Elle aurait tourné la tête. Elle m’aurait vu.
Je ne sais pas combien de temps s’est passé.
C’est juste une cour. Un rectangle d’herbe encadré de béton. Arbustes rachitiques.
Je ne sais pas pourquoi je regarde ça.
Je pensais que j’étais fatigué. Mais assis je me sens pareil que debout.Je ne veux pas m’allonger. J’aurais peur de ne pas être prêt.
Je vous laisse vous installer, ranger vos affaires. Je reviendrai tout à l’heure.
Elle sort. Il y a un décalage entre les bruits et les mouvements.
J’entends la serrure. Puis.
Silence.
Elle s’adressait à moi. Il m’a fallu un moment pour m’en rendre compte. La personne qu’elle a laissée seule dans cette pièce, c’est moi aussi. Je voulais lui dire que je n’avais pas fini, mais elle a été trop rapide.
À la fenêtre je pensais voir la rue. Je voulais la voir partir. Pas elle. Ma femme. J’ai peut-être oublié de lui dire quelque chose. Je ne sais pas. Elle aurait été sur le trottoir. Elle aurait tourné la tête. Elle m’aurait vu.
Je ne sais pas combien de temps s’est passé.
C’est juste une cour. Un rectangle d’herbe encadré de béton. Arbustes rachitiques.
Je ne sais pas pourquoi je regarde ça.
Je pensais que j’étais fatigué. Mais assis je me sens pareil que debout.Je ne veux pas m’allonger. J’aurais peur de ne pas être prêt.
Edith Vanel
Cendre et kori
Tu as essayé ce jour-là, tu as essayé de t’avoir. Par-delà la page, je pouvais te voir, comme je t’ai vu, ce matin-là, dans la salle de bains. Ce n’est qu’après que j’ai compris, au bruit de l’ambulance, et devant ton poignet cigarette brûlée, tes yeux noirs couleur cigarette brûlée, tes yeux tout noirs. Tu avais essayé et tu t’étais raté. Entre les murs de la salle de bains, ton ombre étrange et sa chair, son poids, son odeur que je pouvais sentir au-delà de la porte. Alors j’ai vu soudain tes yeux de terre et tu es sorti. Tu es sorti, et plus tard je t’ai retrouvé assis, dans une salle d’hôpital. Nous tous, par-delà les pages de temps, de villes et d’espaces, nous avions le ventre coupé en deux avec toi pour ainsi dire, mais moi je croyais savoir. Je savais, oui, je savais quand j’ai vu ton œil cigarette s’ouvrir sans fond dans une chambre d’hôpital. J’ai vu le long serpent enroulé autour de ton cœur qui faisait tomber la cendre, comme des feuilles, lente et sans pesanteur. Tu ne pouvais pas parler encore. Tu fumais en silence, le bout de tes doigts tremblait encore, c’était presque imperceptible. Tu étais dans un pyjama froissé, je t’en ai apporté un autre avec le journal et les feuilles Canson et les crayons de couleurs. Tu les as pris, posés sur la table, comme des objets à toi, rien qu’à toi, avec cette façon distante et reculée de t’éloigner, de t’enfouir bien profondément hors de nous. Loin, par-delà les pages, et les portes ouvertes où entrait le vent
Tu as essayé ce jour-là, tu as essayé de t’avoir. Par-delà la page, je pouvais te voir, comme je t’ai vu, ce matin-là, dans la salle de bains. Ce n’est qu’après que j’ai compris, au bruit de l’ambulance, et devant ton poignet cigarette brûlée, tes yeux noirs couleur cigarette brûlée, tes yeux tout noirs. Tu avais essayé et tu t’étais raté. Entre les murs de la salle de bains, ton ombre étrange et sa chair, son poids, son odeur que je pouvais sentir au-delà de la porte. Alors j’ai vu soudain tes yeux de terre et tu es sorti. Tu es sorti, et plus tard je t’ai retrouvé assis, dans une salle d’hôpital. Nous tous, par-delà les pages de temps, de villes et d’espaces, nous avions le ventre coupé en deux avec toi pour ainsi dire, mais moi je croyais savoir. Je savais, oui, je savais quand j’ai vu ton œil cigarette s’ouvrir sans fond dans une chambre d’hôpital. J’ai vu le long serpent enroulé autour de ton cœur qui faisait tomber la cendre, comme des feuilles, lente et sans pesanteur. Tu ne pouvais pas parler encore. Tu fumais en silence, le bout de tes doigts tremblait encore, c’était presque imperceptible. Tu étais dans un pyjama froissé, je t’en ai apporté un autre avec le journal et les feuilles Canson et les crayons de couleurs. Tu les as pris, posés sur la table, comme des objets à toi, rien qu’à toi, avec cette façon distante et reculée de t’éloigner, de t’enfouir bien profondément hors de nous. Loin, par-delà les pages, et les portes ouvertes où entrait le vent
Isabelle Renaud
L’Alboum
Le taxi s’arrêta rue de L’Oliveraie, sous le soleil. Ils dégagèrent du coffre la poussette et les sacs, payèrent le chauffeur et la voiture fila.
– On est où, papa ? demanda la petite en prenant Tigrou dans ses bras.
– Chez mes parents, dit David. Ce sont tes grands-parents aussi, ils s’appellent Hector et Regina.
Ils poussèrent le portail du jardin et tout de suite entendirent les accords galopants d’une cantate de Bach. Derrière la fenêtre, une vieille dame de dos était installée au piano, cheveux blancs coupés court et robe de chambre bleue. Sophie prit l’enfant dans ses bras.
– Regarde Alice, c’est ta grand-mère !
Elle tapa au carreau, la grand-mère se retourna et sa bouche fit un O de surprise. Aussitôt la silhouette sortit du cadre, et la porte d’entrée s’ouvrit. David se retrouva vigoureusement enlacé, Sophie, la nuque tiraillée, reçut un baiser sonore sur le crâne. La petite restait en retrait, observant cette vieille dame agitée, en pantoufles et chemise de nuit.
– Alice ! Alice ma chérie, viens voir ! J’ai fait une crèche pour toi !
Regina attrapa l’enfant par la main et les précéda dans le couloir. Dans le salon, sur la table basse recouverte d’un crépon turquoise, se dressait une crèche de Noël avec des bateaux, des poissons, de petits pêcheurs de terre glaise. Regina se baissa pour allumer une guirlande électrique.
– Regarde Alice, comme c’est joli ! Cette année, le thème, c’est la mer !
La petite regardait le sol, serrait son tigre contre elle.
– Papa n’est pas là ? demanda David en repliant la poussette d’un coup de genou adroit.
– Oh, ton père ! Il est à l’hôpital. Il a fait l’andouille toute la journée d’hier avec ses championnats d’échecs, et…
La petite s’approcha de la crèche, tendit les mains vers un bateau de guerre.– Alors Alice, ça te plaît ? s’empressa Regina en guidant la main de l’enfant sur la table.
Le taxi s’arrêta rue de L’Oliveraie, sous le soleil. Ils dégagèrent du coffre la poussette et les sacs, payèrent le chauffeur et la voiture fila.
– On est où, papa ? demanda la petite en prenant Tigrou dans ses bras.
– Chez mes parents, dit David. Ce sont tes grands-parents aussi, ils s’appellent Hector et Regina.
Ils poussèrent le portail du jardin et tout de suite entendirent les accords galopants d’une cantate de Bach. Derrière la fenêtre, une vieille dame de dos était installée au piano, cheveux blancs coupés court et robe de chambre bleue. Sophie prit l’enfant dans ses bras.
– Regarde Alice, c’est ta grand-mère !
Elle tapa au carreau, la grand-mère se retourna et sa bouche fit un O de surprise. Aussitôt la silhouette sortit du cadre, et la porte d’entrée s’ouvrit. David se retrouva vigoureusement enlacé, Sophie, la nuque tiraillée, reçut un baiser sonore sur le crâne. La petite restait en retrait, observant cette vieille dame agitée, en pantoufles et chemise de nuit.
– Alice ! Alice ma chérie, viens voir ! J’ai fait une crèche pour toi !
Regina attrapa l’enfant par la main et les précéda dans le couloir. Dans le salon, sur la table basse recouverte d’un crépon turquoise, se dressait une crèche de Noël avec des bateaux, des poissons, de petits pêcheurs de terre glaise. Regina se baissa pour allumer une guirlande électrique.
– Regarde Alice, comme c’est joli ! Cette année, le thème, c’est la mer !
La petite regardait le sol, serrait son tigre contre elle.
– Papa n’est pas là ? demanda David en repliant la poussette d’un coup de genou adroit.
– Oh, ton père ! Il est à l’hôpital. Il a fait l’andouille toute la journée d’hier avec ses championnats d’échecs, et…
La petite s’approcha de la crèche, tendit les mains vers un bateau de guerre.– Alors Alice, ça te plaît ? s’empressa Regina en guidant la main de l’enfant sur la table.
Pierre Ducrozet
Dans sa cage de velours
Il est là depuis quelques jours sur la table je ne sais pas trop quoi en faire il est là il me regarde et parfois il dégouline un peu je n'ose pas le toucher le déplacer j'ai peur qu'il m'explose dans les mains que dois-je faire le regarder encore des jours et des jours, ma chambre est petite et il est là ici partout je le vois il me voit il sursaute parfois et c'est effrayant croyez-moi, il fait un petit bond et retombe, net, dans un schploc qui me glace, qui me l'a envoyé je ne sais pas aucune adresse sur le colis rien qui a bien pu m'envoyer une chose aussi ah ! et il remue aussi, surtout le soir, le carton tourne sur lui-même et on entend comme un soupir dans l'air, la nuit ne lui plaît pas trop, et moi non plus, j'ai froid et je suis seule avec cette chose-là, emballée, empaquetée qui a bien pu ? J'ai ma petite idée mais enfin - je ne dors plus vous imaginez il boum-boum dans sa cage et c'est pas rassurant non je me demande pourquoi j'ai envie de le prendre dans mes bras ce maudit colis et son FRAGILE collé de travers comme un emblème je me demande et oh ! le voilà qui saigne non, pas sur le tapis de Chine, je t'en prie tu es ici chez moi ne t'avise pas - c'est du sang pas de doute qui s'agglutine là et tombe goutte à goutte du cassis broyé ça me serre le ventre si je partais en vacances, loin de cette chambre, de cette ville, retrouver les calèches, les frissons, mais nous sommes deux ici à présent et je ne peux le laisser seul - que viens-tu de dire ? tu perds la tête, laisse le colis empoisonné et pars
Il est là depuis quelques jours sur la table je ne sais pas trop quoi en faire il est là il me regarde et parfois il dégouline un peu je n'ose pas le toucher le déplacer j'ai peur qu'il m'explose dans les mains que dois-je faire le regarder encore des jours et des jours, ma chambre est petite et il est là ici partout je le vois il me voit il sursaute parfois et c'est effrayant croyez-moi, il fait un petit bond et retombe, net, dans un schploc qui me glace, qui me l'a envoyé je ne sais pas aucune adresse sur le colis rien qui a bien pu m'envoyer une chose aussi ah ! et il remue aussi, surtout le soir, le carton tourne sur lui-même et on entend comme un soupir dans l'air, la nuit ne lui plaît pas trop, et moi non plus, j'ai froid et je suis seule avec cette chose-là, emballée, empaquetée qui a bien pu ? J'ai ma petite idée mais enfin - je ne dors plus vous imaginez il boum-boum dans sa cage et c'est pas rassurant non je me demande pourquoi j'ai envie de le prendre dans mes bras ce maudit colis et son FRAGILE collé de travers comme un emblème je me demande et oh ! le voilà qui saigne non, pas sur le tapis de Chine, je t'en prie tu es ici chez moi ne t'avise pas - c'est du sang pas de doute qui s'agglutine là et tombe goutte à goutte du cassis broyé ça me serre le ventre si je partais en vacances, loin de cette chambre, de cette ville, retrouver les calèches, les frissons, mais nous sommes deux ici à présent et je ne peux le laisser seul - que viens-tu de dire ? tu perds la tête, laisse le colis empoisonné et pars
Chantal Colombier
Mille morceaux
Pierre monte l'escalier, grimpe les marches, deux par deux, quatre à quatre.
Aujourd'hui, Martin ne lui ouvrira pas la porte.
Un accident banal. Fauché par un poids lourd en plein après-midi, en pleine semaine, en plein Paris. Il est sorti de sa voiture. Il a ouvert la portière. Le chauffeur du camion ne l'a pas vu. Il tenait un téléphone portable dans sa main gauche. Une moto a surgi sur la droite. Un concours de circonstances. Le camion qui n'a rien vu, la distraction de Martin, la vitesse de la moto, le piéton qui a traversé au dernier moment, le feu qui est passé au vert, le bus qui a déboîté, le chien de la vieille dame qui s'est précipité dans le caniveau... La police judiciaire va tenter de reconstituer ce qui s'est passé. Autant d'indices, autant de pistes possibles. Des témoins à interroger. Des bris de verre à ramasser. Des notes à inscrire sur les carnets des enquêteurs. Une seule histoire à raconter. Celle de l'accident. Le décès de Martin. Rétablir l'histoire, refaire la chronologie, recoller les morceaux. Une histoire en mille morceaux. La vie de Martin qui s'est brisée. Brisée en mille morceaux. Martin est mort pendant son transport à l'hôpital.
Pierre monte l'escalier, grimpe les marches, deux par deux, quatre à quatre.
Aujourd'hui, Martin ne lui ouvrira pas la porte.
Un accident banal. Fauché par un poids lourd en plein après-midi, en pleine semaine, en plein Paris. Il est sorti de sa voiture. Il a ouvert la portière. Le chauffeur du camion ne l'a pas vu. Il tenait un téléphone portable dans sa main gauche. Une moto a surgi sur la droite. Un concours de circonstances. Le camion qui n'a rien vu, la distraction de Martin, la vitesse de la moto, le piéton qui a traversé au dernier moment, le feu qui est passé au vert, le bus qui a déboîté, le chien de la vieille dame qui s'est précipité dans le caniveau... La police judiciaire va tenter de reconstituer ce qui s'est passé. Autant d'indices, autant de pistes possibles. Des témoins à interroger. Des bris de verre à ramasser. Des notes à inscrire sur les carnets des enquêteurs. Une seule histoire à raconter. Celle de l'accident. Le décès de Martin. Rétablir l'histoire, refaire la chronologie, recoller les morceaux. Une histoire en mille morceaux. La vie de Martin qui s'est brisée. Brisée en mille morceaux. Martin est mort pendant son transport à l'hôpital.
Julien Daillère
Je suis une petite fille moche
Je suis une petite fille moche.
Je suis pas handicapée, j’ai pas une grosse cicatrice ou une tache de naissance sur la figure, ni un gros grain de beauté mal placé. J’ai pas d’excuses comme ça. Je sais pas trop de quoi ça vient. Si c’est mon nez qu’est trop long ou mon visage trop petit. Si c’est mes yeux qui sont trop rapprochés ou bien quoi. Je sais pas trop dire pourquoi mais je me regarde et je me trouve moche. Et les autres, ils pensent la même chose. Je suis une petite fille moche.
Les grandes personnes, elles, elles commencent toujours par me sourire quand elles me voient pour la première fois. Parce que je suis une petite fille alors on me sourit. Et puis tout d’un coup elles sourient plus pareil. Comme si elles avaient envie d’arrêter de sourire mais qu’il fallait bien continuer parce que je suis peut-être moche mais je suis quand même une petite fille, mais qu’est-ce que je suis moche quand même, et qu’est-ce que c’est triste une petite fille aussi moche.
Parce que ça leur fait de la peine aux adultes quand ils me regardent, tellement je suis moche.
Ils sont désolés, ils aimeraient bien faire quelque chose pour m’aider. Ils deviennent tout gentils et ils veulent me protéger parce qu’ils savent bien que quand on est moche, être une petite fille, bah c’est pas facile.
Je suis une petite fille moche.
Je suis pas handicapée, j’ai pas une grosse cicatrice ou une tache de naissance sur la figure, ni un gros grain de beauté mal placé. J’ai pas d’excuses comme ça. Je sais pas trop de quoi ça vient. Si c’est mon nez qu’est trop long ou mon visage trop petit. Si c’est mes yeux qui sont trop rapprochés ou bien quoi. Je sais pas trop dire pourquoi mais je me regarde et je me trouve moche. Et les autres, ils pensent la même chose. Je suis une petite fille moche.
Les grandes personnes, elles, elles commencent toujours par me sourire quand elles me voient pour la première fois. Parce que je suis une petite fille alors on me sourit. Et puis tout d’un coup elles sourient plus pareil. Comme si elles avaient envie d’arrêter de sourire mais qu’il fallait bien continuer parce que je suis peut-être moche mais je suis quand même une petite fille, mais qu’est-ce que je suis moche quand même, et qu’est-ce que c’est triste une petite fille aussi moche.
Parce que ça leur fait de la peine aux adultes quand ils me regardent, tellement je suis moche.
Ils sont désolés, ils aimeraient bien faire quelque chose pour m’aider. Ils deviennent tout gentils et ils veulent me protéger parce qu’ils savent bien que quand on est moche, être une petite fille, bah c’est pas facile.
Françoise Malène
Perdre
de plus en plus je perdais
je perdais dans le train la pomme du déjeuner la thermos que je m’étais réjouie d’avoir trouvée en solde
mon imperméable neuf avec dans la poche les clefs de l’appartement où je ne pouvais plus rentrer qu’en demandant l’ouverture aux voisins
j’allais au bout du quai pousser la porte en fer du bureau des objets trouvés la préposée derrière ses registres me disait que non elle n’avait rien qui ressemblait à ça juste peluche abandonnée je n’avais qu’à repasser demain peut-être
je repassais j’attendais qu’elle ait fini vieille pourtant le corps lâche de raconter ses couches au téléphone
autrefois
je perdais des carnets des copies déjà corrigées avec mes mots à l’encre rouge contre les leurs pour endiguer redresser leur donner à eux les étais qui ne me portaient plus et de cette transfusion vidée
j’oubliais quelque part les feuilles
eux sidérés que j’aie pu et je disais je me souviens très bien des fautes quand même les copies à quoi ça sert alors de
travailler pour rien
de plus en plus je perdais
je perdais dans le train la pomme du déjeuner la thermos que je m’étais réjouie d’avoir trouvée en solde
mon imperméable neuf avec dans la poche les clefs de l’appartement où je ne pouvais plus rentrer qu’en demandant l’ouverture aux voisins
j’allais au bout du quai pousser la porte en fer du bureau des objets trouvés la préposée derrière ses registres me disait que non elle n’avait rien qui ressemblait à ça juste peluche abandonnée je n’avais qu’à repasser demain peut-être
je repassais j’attendais qu’elle ait fini vieille pourtant le corps lâche de raconter ses couches au téléphone
autrefois
je perdais des carnets des copies déjà corrigées avec mes mots à l’encre rouge contre les leurs pour endiguer redresser leur donner à eux les étais qui ne me portaient plus et de cette transfusion vidée
j’oubliais quelque part les feuilles
eux sidérés que j’aie pu et je disais je me souviens très bien des fautes quand même les copies à quoi ça sert alors de
travailler pour rien
Max Marcuzzi
Champagne habituel
1. Tempus locusque. Un samedi de décembre, entre l’hôpital Saint-Louis et le canal Saint-Martin, peu après quatre heures. Hélène attend son nouvel ami, guitariste de rock, dans le studio d’enregistrement du groupe, au premier étage de la maison du chanteur. Il est en retard. En son absence, Hélène est accueillie par la maîtresse des lieux, poétesse souriante qui lui semble flotter avec grâce au bout des talons qui la gardent éloignée de la prose du sol.
La pièce de l’étage est divisée par une large cloison de verre derrière laquelle se trouve l’espace insonorisé où le groupe enregistre les maquettes de ses morceaux. Pour l'heure, on n’y trouve que deux tabourets, des pieds de micros et quelques bouteilles de vodka vides. Sur les murs s’exposent des affiches de concert et des agrandissements de pochettes de disques.
Hélène passe lentement de la contemplation d’un objet à l’autre. Puis elle regarde sa montre. Il est maintenant quatre heures et demie passées. Elle consulte son téléphone mobile, voit qu’il n’y a pas d’appel sur la messagerie, hésite à joindre Xavier, vérifie le volume de la sonnerie, qui est déjà au maximum, et range le mobile dans son sac en se retenant de soupirer.
1. Tempus locusque. Un samedi de décembre, entre l’hôpital Saint-Louis et le canal Saint-Martin, peu après quatre heures. Hélène attend son nouvel ami, guitariste de rock, dans le studio d’enregistrement du groupe, au premier étage de la maison du chanteur. Il est en retard. En son absence, Hélène est accueillie par la maîtresse des lieux, poétesse souriante qui lui semble flotter avec grâce au bout des talons qui la gardent éloignée de la prose du sol.
La pièce de l’étage est divisée par une large cloison de verre derrière laquelle se trouve l’espace insonorisé où le groupe enregistre les maquettes de ses morceaux. Pour l'heure, on n’y trouve que deux tabourets, des pieds de micros et quelques bouteilles de vodka vides. Sur les murs s’exposent des affiches de concert et des agrandissements de pochettes de disques.
Hélène passe lentement de la contemplation d’un objet à l’autre. Puis elle regarde sa montre. Il est maintenant quatre heures et demie passées. Elle consulte son téléphone mobile, voit qu’il n’y a pas d’appel sur la messagerie, hésite à joindre Xavier, vérifie le volume de la sonnerie, qui est déjà au maximum, et range le mobile dans son sac en se retenant de soupirer.
Dan Sasson
Le jardin
L’homme ne s’était jamais vraiment habitué à ne pas marcher pieds nus. Il regardait ses souliers luxueux tout crottés, au cuir crevassé, aux semelles éclatées, une paire de bottines anglaises dont il avait retourné le bord sur la cheville, une de celles qu’il préférait et n’avait plus quittées ni lacées depuis plusieurs semaines. Il pensait aux plus beaux modèles qu’il avait possédés, à ces derbys trois œillets de chez Glove qu’il portait jadis au quotidien, à sa collection de mocassins Simoni, tous plus raffinés les uns que les autres, à ces richelieus vernis qu’il réservait aux grandes occasions. Il pensait à l’atelier de ce vieux bottier hongrois, un génie méconnu, qu’il avait élu comme chausseur exclusif durant des années et dont il n’avait jamais pu faire le deuil. Il pensait à cette paire unique de boots en peau de buffle de l’Armée des Indes qu’il avait dénichée chez un brocanteur londonien et qu’il porterait certainement encore si on ne les lui avait pas dérobées avec le reste de ses bagages au cours d’un de ses nombreux voyages. Il pensait aux brodequins à boucles de sa jeunesse, aux lourdes sandales de son enfance, quand, sans vraiment s’en rendre compte, sans décoller le dos du fauteuil en osier qui craquait doucement sous son poids, en s’aidant uniquement de la pointe des pieds, il envoya valdinguer un à un ses souliers.